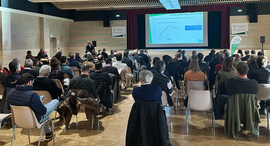Le président du CSS, Guy Richard, a accueilli les participants en énonçant les objectifs de la journée, qui s’est déroulée sous le signe des échanges constructifs et du partage d’expériences et de résultats.
Les porteurs de projets ont ensuite présenté leurs travaux et échangé avec les partenaires, le CSS et le Comité de Coordination Technique (CCT). Pour rappel, 5 projets distincts constituent le PNRI-C :
- ABOS :Développement d’un biocontrôle en traitement de semences basé sur les composés organiques volatils (COV).
- BEET-SAT : Surveillance à large échelle pour identifier les facteurs de risque jaunisse.
- Biocontrôle-C : Optimisation de produits de biocontrôle aphicides et biostimulants contre la jaunisse et ses vecteurs.
- FPE-C : Tests sur 50 parcelles agricoles pour valider des itinéraires de protection en conditions réelles.
- REDIVIBE : Étude des réservoirs de virus et des vecteurs de transmission pour mieux comprendre la dissémination de la maladie.
Des résultats à mi-parcours
Plus de 50 fermes pilotes expérimentent des itinéraires visant à réduire la pression en pucerons. Les premiers résultats indiquent une diminution d’environ 50 % des pucerons verts grâce aux plantes compagnes comme l’avoine rude et l’orge de printemps, tout en rappelant les limites agronomiques qui restent à surmonter.
Les travaux sur les chrysopes, les allomones, les phéromones ou encore un champignon entomopathogène montrent également un potentiel, bien que leur efficacité nécessite des validations complémentaires.
Depuis 2021, une vingtaine de substances actives de biocontrôle ont été testés sous serre, dont certains présentent des résultats significatifs. Des essais au champ sont prévus pour 2026 afin de confirmer ces observations. En parallèle, des approches plus exploratoires émergent, comme l’intégration de composés organiques volatils dans l’enrobage des semences.
Le programme progresse également dans la compréhension des réservoirs de virus et de pucerons. Les travaux d’INRAE montrent notamment que le colza, d'autres brassicacées et la phacélie constituent des réservoirs majeurs pour Myzus persicae, alors que les repousses de betteraves sucrières ou porte-graines apparaissent comme les seuls réservoirs capables d’héberger les quatre virus de la jaunisse.
Enfin, le projet BEET-SAT, lancé en septembre, a pour objectif de comprendre les facteurs explicatifs de la sévérité de jaunisse à partir de données de télédétection, du climat, des cultures environnantes, des éléments paysagers.
Plus de détails sur les résultats du PNRI-C dans le communiqué de presse disponible ici
L’ensemble de ces travaux confirme la pertinence d’une stratégie "multi-leviers" alliant prophylaxie, agronomie, biocontrôle et analyse de risque. Avec des résultats concrets déjà visibles et des perspectives solides pour 2026, le PNRI-C mobilise chercheurs, ITB et professionnels de la filière pour faire émerger des solutions durables contre la jaunisse de la betterave.