

Les dernières observations avant récolte sont saisies dans l’outil Vigicultures, mais les données du réseau de Surveillance Biologique du Territoire (SBT) accumulées jusque-ici permettent de dresser un premier bilan, notamment des saisons printanières et estivales.

 Bien qu'observés dès le 11 avril, le développement des pucerons verts a été ralenti par quelques épisodes de froid et maitrisé par des interventions aphicides renouvelées. Les pucerons noirs, observés à partir de la fin avril, ont aussi été présents tout au long du printemps. Alors que les observateurs s’attendaient à une régression naturelle des pucerons à partir de fin mai, une prolifération exceptionnelle, en particulier de leurs populations ailées, a été observée jusqu’au retour de la canicule à partir du 19 juin (semaine 25).
Bien qu'observés dès le 11 avril, le développement des pucerons verts a été ralenti par quelques épisodes de froid et maitrisé par des interventions aphicides renouvelées. Les pucerons noirs, observés à partir de la fin avril, ont aussi été présents tout au long du printemps. Alors que les observateurs s’attendaient à une régression naturelle des pucerons à partir de fin mai, une prolifération exceptionnelle, en particulier de leurs populations ailées, a été observée jusqu’au retour de la canicule à partir du 19 juin (semaine 25).
 En ce qui concerne les autres ravageurs aériens de ce printemps, peu de thrips ont été observés, trois fois moins que la moyenne pluriannuelle, et de même peu d’altises, moins de 3 % des sites ont atteint le seuil d’intervention. De plus d’autres ravageurs ont certes été présents, mais avec un impact limité sur les betteraves : c’est le cas des pégomyies, atteignant le seuil d’intervention dans moins de 12 % des parcelles. C’est également le cas des collemboles, qui n’ont pas rongé les betteraves, déjà bien développées au moment de leur présence.
En ce qui concerne les autres ravageurs aériens de ce printemps, peu de thrips ont été observés, trois fois moins que la moyenne pluriannuelle, et de même peu d’altises, moins de 3 % des sites ont atteint le seuil d’intervention. De plus d’autres ravageurs ont certes été présents, mais avec un impact limité sur les betteraves : c’est le cas des pégomyies, atteignant le seuil d’intervention dans moins de 12 % des parcelles. C’est également le cas des collemboles, qui n’ont pas rongé les betteraves, déjà bien développées au moment de leur présence.
 Les ravageurs souterrains ont été aussi assez peu présents, 8 % des sites cette année, dont un peu plus de la moitié des sites touchés par des tipules, favorisées par des pluies abondantes suivies de coups de chaleur.
Les ravageurs souterrains ont été aussi assez peu présents, 8 % des sites cette année, dont un peu plus de la moitié des sites touchés par des tipules, favorisées par des pluies abondantes suivies de coups de chaleur.
La pression des limaces est revenue cette année à une normale, après le printemps exceptionnellement humide de l’an dernier.
 En revanche, on aurait pu s’attendre à une absence de mildiou compte tenu des conditions climatiques défavorables de ce printemps, contrairement à l’an dernier (20 % des sites touchés avec en moyenne 10 % des betteraves atteintes). Cette maladie a tout de même été observée dans 3 % des sites, sachant que son observation est compliquée par la présence concomitante de jaunisse, source de confusion des symptômes.
En revanche, on aurait pu s’attendre à une absence de mildiou compte tenu des conditions climatiques défavorables de ce printemps, contrairement à l’an dernier (20 % des sites touchés avec en moyenne 10 % des betteraves atteintes). Cette maladie a tout de même été observée dans 3 % des sites, sachant que son observation est compliquée par la présence concomitante de jaunisse, source de confusion des symptômes.
Plus de détails et des témoignages régionaux dans le BF 1206
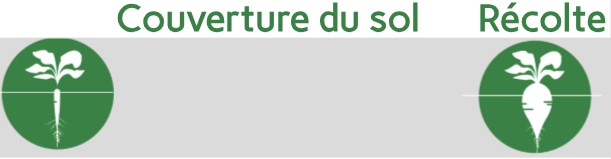
 Les premières taches de cercosporiose ont été observées précocement, le 16 juin en région Centre, et le 23 juin dans les autres régions, entrainant pour ces parcelles les premières interventions fongicides, qui se sont étalées jusqu’à début aout pour les plus tardives. La cercosporiose reste la maladie dominante de cette année, même si l’oïdium, ainsi que la rouille, ont pu atteindre le seuil d’intervention dans la partie ouest des régions betteravières. En moyenne 2,2 interventions fongicides ont été nécessaires pour contenir les maladies. Une application supplémentaire a été nécessaire dans les zones à pression historique en cercosporiose.
Les premières taches de cercosporiose ont été observées précocement, le 16 juin en région Centre, et le 23 juin dans les autres régions, entrainant pour ces parcelles les premières interventions fongicides, qui se sont étalées jusqu’à début aout pour les plus tardives. La cercosporiose reste la maladie dominante de cette année, même si l’oïdium, ainsi que la rouille, ont pu atteindre le seuil d’intervention dans la partie ouest des régions betteravières. En moyenne 2,2 interventions fongicides ont été nécessaires pour contenir les maladies. Une application supplémentaire a été nécessaire dans les zones à pression historique en cercosporiose.
 Les conditions climatiques orageuses ont ralenti le développement non seulement des teignes, mais aussi des charançons. Les dégâts de teignes n’ont été observés que dans 33 % des parcelles, en Champagne, au sud de Paris, et dans quelques secteurs du nord-est de Paris. Les fréquences les plus importantes ont été cette année concentrées en Champagne.
Les conditions climatiques orageuses ont ralenti le développement non seulement des teignes, mais aussi des charançons. Les dégâts de teignes n’ont été observés que dans 33 % des parcelles, en Champagne, au sud de Paris, et dans quelques secteurs du nord-est de Paris. Les fréquences les plus importantes ont été cette année concentrées en Champagne.
 Le charançon Lixus Juncii s'est manifesté dans des parcelles situées en majorité au sud de Paris, et dans une moindre mesure en Champagne. Des piqures ont été relevées dans 61 % des sites du réseau. Mais la présence de galeries, symptômes les plus dommageables, qui impliquent la migration des larves depuis les pétioles vers les racines, a été faible cette année. Elle a concerné 1 parcelle sur 3 parmi les parcelles touchées, et ce en majorité au sud de Paris.
Le charançon Lixus Juncii s'est manifesté dans des parcelles situées en majorité au sud de Paris, et dans une moindre mesure en Champagne. Des piqures ont été relevées dans 61 % des sites du réseau. Mais la présence de galeries, symptômes les plus dommageables, qui impliquent la migration des larves depuis les pétioles vers les racines, a été faible cette année. Elle a concerné 1 parcelle sur 3 parmi les parcelles touchées, et ce en majorité au sud de Paris.
 Le suivi des cicadelles vectrices du SBR et du RTD, du genre Pentastiridius, a été renforcé. Des cicadelles vectrices du SBR ont été capturées en Alsace uniquement. D’autres cicadelles ont été observées dans les autres zones, mais aucune espèce vectrice des maladies bactériennes.
Le suivi des cicadelles vectrices du SBR et du RTD, du genre Pentastiridius, a été renforcé. Des cicadelles vectrices du SBR ont été capturées en Alsace uniquement. D’autres cicadelles ont été observées dans les autres zones, mais aucune espèce vectrice des maladies bactériennes.
Plus de détails et témoignages régionaux dans le BF 1207
Le réseau d'épidémiosurveillance permet de suivre les bioagresseurs grâce à l'observation de 200 à 300 parcelles betteravières. Grâce à la mobilisation d'une centaine d'observateurs, les animateurs régionaux publient chaque semaine l'état de santé des betteraves dans les Bulletins de Santé du Végétal (BSV). De plus, ces données alimentent en temps réel les outils Alerte de l'ITB.
Agrément conseil de l’ITB à l’utilisation des produits phytosanitaires n° 7500002.
Assurance RC n° 05421646Y/1025.
Le portail EcophytoPIC recense les techniques alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Organisme agréé Crédit d'impôt Recherche
L'Institut Technique de la Betterave est
membre du réseau Acta
Institut Technique Agricole Qualifié
par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation