

Le mildiou de la betterave est dû à un oomycète ou pseudo-champignon, spécifique du genre Beta, qui se développe principalement lorsque les conditions printanières sont plutôt froides mais surtout humides. La pluie est en effet essentielle au développement du pathogène. Les dégâts en production de betteraves sucrières sont en général limités, sauf les années où les conditions climatiques lui sont particulièrement favorables comme 2014 ou cette année 2024, avec des surfaces touchées à hauteur de 40 % dans certaines parcelles.
Le micro-organisme à l’origine du mildiou de la betterave est un oomycète. Longtemps apparenté aux champignons par sa structure (filament produisant du mycélium, libération de spores, et nutrition à partir de matière organique), il est désormais considéré comme une branche différente, plus proche phylogénétiquement des algues, peut-être une forme d’algue brune ayant perdu au cours de l’évolution sa capacité photosynthétique (PEGG et al. 2015) & (THINES Marco, CHOI Young-Joon, 2015).
Les oomycètes sont des organismes vivant soit dans l’eau soit sur de la matière organique en décomposition, soit comme parasites. Certains sont ainsi des parasites majeurs des végétaux, notamment le genre des péronosporales, responsables des mildious (entre autres le mildiou de la pomme de terre et de la tomate Phytophtora infestans, le mildiou du rosier Peronospora sparsa, le mildiou de la vigne Plasmopara viticola, le mildiou du tabac Peronospora tabacina), mais aussi les pithiums, responsables des fontes de semis ou bien les Aphanomyces (PEGG et al. 2015) & (THINES Marco, CHOI Young-Joon, 2015).
Le mildiou de la betterave (Peronospora schachtii), est devenu un parasite strict, c’est-à-dire dépendant entièrement d’un hôte vivant pour sa nutrition et sa reproduction. Il est spécifique du genre Beta, et attaque les betteraves sucrières, potagères, fourragères, porte-graines, sauvages et les bettes. Malgré sa ressemblance avec les autres mildious des chénopodiacées, il s’agit donc d’une espèce différente, notamment de celle attaquant les épinards (Peronospora effusa) avec laquelle il a été longtemps associé. (CHOI, HONG, SHIN, 2007) & (THINES Marco, CHOI Young-Joon, 2015).
❶ Contamination primaire
La contamination primaire se fait sur les jeunes plantules :
Les betteraves sont particulièrement sensibles dès la levée. La sensibilité diminue avec l’âge. A partir du stade 10-12 feuilles, les plantes semblent plus résistantes, puisqu’aucune contamination naturelle n’a été observée malgré la présence de nombreuses conidies (spores asexuées) dans le champ (ITB, DARPOUX, 1962).
![]() Pluie > projection sur une plantule
Pluie > projection sur une plantule
❷ Développement dans la plantule
Cette spore germe à une température optimum de 4°C et pénètre par les stomates via un tube germinatif en l’absence d’eau ou par le déplacement de la spore en cas de présence d’un film d’eau sur la surface de la feuille (LYSLE D. LEACH, 1931) & (PHILIP DRAYCOTT, 2006) & (PEGG et al. 2015). Le mycélium va ensuite se développe ensuite à l’intérieur de la plante et puiser via des suçoirs les nutriments dont il a besoin pour se développer. Il envahit la plante jusqu’à la base des pétioles, au niveau du collet, et des bourgeons axillaires, ce qui lui permet d’infecter directement par voie interne les nouvelles feuilles en formation (ITB, DARPOUX, 1962).
![]() Température comprise entre 0.5 et 30 °C - Optimum 4-7 °C
Température comprise entre 0.5 et 30 °C - Optimum 4-7 °C
![]() Humidité élevée (90 %)
Humidité élevée (90 %)
❸ Multiplication et dissémination
Le champignon se développe de façon systémique dans la plante et forme des conidiophores (organes produisant des spores, vecteurs de dispersion). Les spores (conidies) sont produites à une température de 5-20°Cc avec une humidité relative de 80-90 % et un optimum de production compris entre 8 et 10°Cc et 90 % d’humidité relative. Elles sont de couleur gris sale au niveau du feutrage violacé qui apparait d’abord sur la face inférieure des feuilles, mais aussi parfois sur la face supérieure (DELEPLANQUE & CIE, 1999). Ce feutrage correspond à une sporulation abondante en conditions humides. Ces spores servent à la fois d’inoculum de contamination primaire et secondaire (PHILIP DRAYCOTT, 2006). Elles sont disséminées par la pluie ou par le vent et provoquent de nouvelles contaminations du point végétatif des plantes voisines tant que les conditions climatiques restent favorables au champignon (DELEPLANQUE & CIE, 1999) & (PHILIP DRAYCOTT, 2006) & (PEGG et al. 2015).
![]() Température comprise entre 5 et 20 °C - Optimum 8-10 °C
Température comprise entre 5 et 20 °C - Optimum 8-10 °C
![]() Humidité élevée (80-90 %)
Humidité élevée (80-90 %)
❹ Survie hivernale
La production de conidies est une multiplication asexuée, mais le champignon possède également une forme de reproduction sexuée, plus rare, qui aboutit à la formation d’œufs (oospores), notamment lorsque les conditions à l’automne deviennent sèches (humidité relative basse) et plus chaudes (température optimum à 20 °C) et que l’hôte est en train de mourir (LYSLE D. LEACH, 1931). La production des conidies est dans ce cas inhibée au profit de la production d’oospores (LYSLE D. LEACH, 1931).
Ces oospores sont conservées sur les graines ou dans le sol, avec les déchets végétaux (DELEPLANQUE & CIE, 1999). Le mildiou de la betterave persiste aussi sous forme de déchets racinaires, des repousses, dans le sol, dans les cultures de porte-graines, chez des espèces du genre Beta, sauvages ou cultivées, et d’une certaine manière, dans les graines, sous forme d’hyphes et d’oospores (PHILIP DRAYCOTT, 2006). Cependant, un hiver rude impacte la conservation du parasite, et réduit significativement l’apparition et les dégâts du pathogène (FARGASOVA, 1993). Le froid ne tue pas les spores, mais limite leur capacité germinative (LYSLE D. LEACH, 1931). De même, l’exposition des spores au soleil direct ou à une certaine luminosité diminue fortement leur capacité germinative (LYSLE D. LEACH, 1931).
![]() Température comprise entre 16 et 24°C - Optimum 20°C
Température comprise entre 16 et 24°C - Optimum 20°C
![]() Humidité défavorable pour la production d’oospores
Humidité défavorable pour la production d’oospores
Les symptômes diffèrent en fonction du stade de développement de la betterave et des conditions climatiques.
❶ Déformation et décoloration des cotylédons. |
❷ Recroquevillement des feuilles du coeur et repousses foliaires en surnombre (2 à 20 fois plus de repousses foliaires que les plantes saines) |
❸ En cas de conditons humides et froides, sporulation, qui se traduit par la présence d’un feutrage violet-grisâtre sur la face inférieure et parfois supérieure des feuilles. |
❹ Si les conditions deviennent ensuite sèches et chaudes, les feuilles les plus âgées palissent, jaunissent, entrainant des confusions avec de la jaunisse (la différenciation se fait alors en froissant les feuilles : les feuilles restent molles en présence de mildiou alors qu’elles sont cassantes en présence de jaunisse). |
Ces symptômes s’observent uniquement sur des betteraves attaquées dès le printemps.
Déformation et allongement du collet. |
Etranglements verticaux au niveau du collet, |
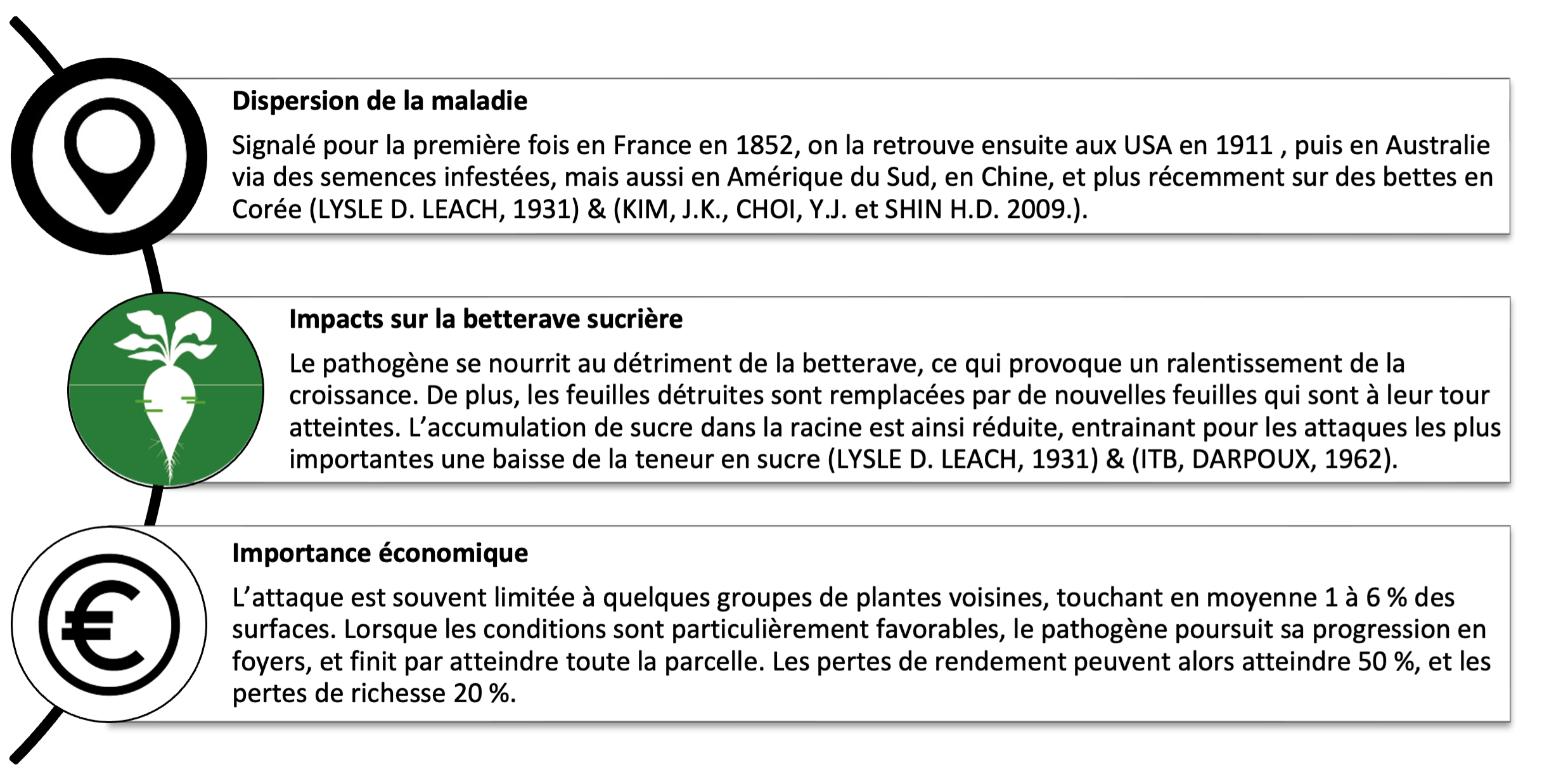
Les attaques sont plus fréquentes et plus graves sur les betteraves porte-graines, les plantes ne produisant pas de graines ou des graines, soit stériles, soit de mauvaise qualité, soit porteuses du pathogène (LYSLE D. LEACH, 1931) & (DELEPLANQUE & CIE, 1999). D’autant plus que d’autres maladies opportunistes profitent de l’affaiblissement des betteraves pour les infester (LYSLE D. LEACH, 1931).
En 2014, 20 % des surfaces de production betteravière ont été touchées avec des gravités très variables par le mildiou, une attaque exceptionnelle, qui n’avait plus été observée depuis près de 50 ans. Cette attaque a amené l’ITB à proposer un questionnaire aux betteraviers afin d’identifier si possible les déterminants de l’infestation.
L’attaque de 2014 :
Les premiers symptômes de mildiou ont été observés dès le mois d’avril pour les parcelles les plus précoces, avec un pic en juin, en lien avec un début d’année très pluvieux succédant à un hiver très doux.
Si la fréquence de parcelles touchées était assez homogène (cf. graphique ci-dessous), les gravités se sont avérées très différentes d’une région à l’autre puisque dans le Nord-Pas-de de-Calais et la Somme la surface parcellaire touchée a pu atteindre 60 %, contre 5 à 15 % en région Centre, voire 1 % dans l’Aisne. La Champagne a été très peu touchée, à mettre en lien avec le déficit de pluviométrie d’avril à juin observé sur le quart nord-est de la France ce printemps-là.
Les surfaces et gravités ont été établies par dires d’experts des régionaux ITB.
L’enquête a permis d’obtenir les retours de plus de 200 agriculteurs, dont 150 exploitables, avec une majorité de répondants touchés (89 %), le manque de répondants non touchés rendant difficile l’identification des déterminants de la maladie. Cependant, plusieurs tendances sont ressorties de l’analyse des réponses :
 |
|
 |
|
|
Il existe peu de méthodes de lutte contre le mildiou, d’autant plus que les attaques d’importance restent exceptionnelles. Il est toutefois essentiel de ne pas confondre une infestation de mildiou, notamment sur une plante isolée avec les premiers symptômes de jaunisse. Certaines familles génétiques sont plus sensibles que d’autres, avec des gravités pouvant varier de 0 à 40 % selon les génétiques.
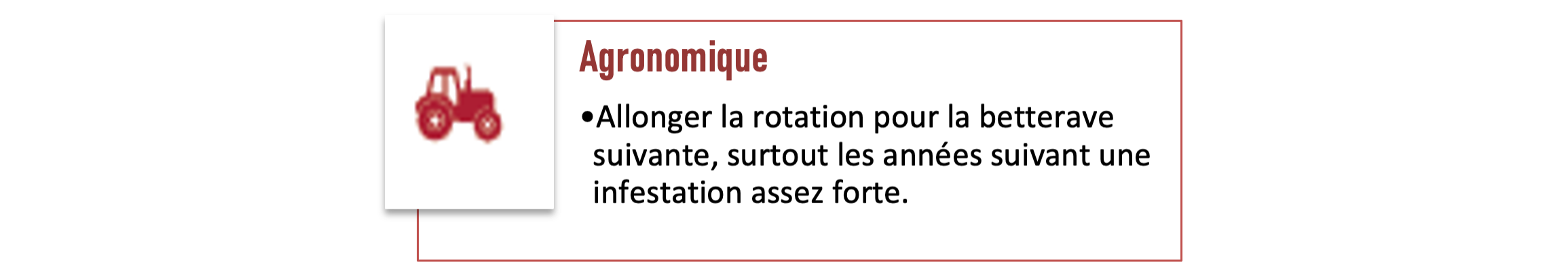
Références BYFORD, W. J. 1967. The Effect of some Cultivation Factors on the Incidence of Downy Mildew in Sugar-beet Root Crops. Plant Pathology. 1967, Vol. 16: 160–161. doi: 10.1111/j.1365-3059.1967.tb00397.x. CHOI Young-Joon, HONG Seung-Beom, SHIN, Hyeon-Dong, 2007. Re-consideration of Peronospora farinosa infecting Spinacia oleracea as distinct species, Peronospora effusa. Mycological Research, Volume 111, Issue 4. April 2007. Pages 381-391. DELEPLANQUE & CIE. 1999. Ennemis et maladies de la betterave sucrière. Mildiou pp 74-75. Maisons-Laffitte : s.n., 1999. FARGASOVA, A. & BOJNANSKY, V. 1993. Sugar‐beet downy mildew (peronospora farinosa/FR./FR. F. SP. betae byf.) in the direct sown seed crops in central Europe. s.l. : Phytopathology And Plant Protection, 1993. Volume 28, Issue 3. INGRAM, D.S & IRENE JOACHIM. 1971. The Growth of Peronospora farinosa f. sp. betae and Sugar Beet Callus Tissues in Dual Culture. Journal of General Microbiology. Printed in Great Britain, 1971, Vol. 69, 211-220. ITB. 2009. Les autres maladies racinaires des betteraves à identifier à la récolte et leurs moyens de lutte. La Technique Betteravière. Le Betteravier Français, 22 septembre 2009, Vol. n°917. ITB, DARPOUX. 1962. Etudes sur le mildiou de la betterave. s.l. : CR des travaux effectués en 1961, XXVème congrès de l'IIRB, 1962. ITB, IRBAB, IRS, NORDIC SUGAR, LIZ & BISZ. 2009. DIAGBET maladies et parasites. [En ligne] 2009. schaeden.rheinmedia.de/cgi-bin/schaedlinge_ausgabe.cgi KIM, J.K., CHOI, Y.J. et SHIN H.D. 2009. Downy mildew caused by Peronospora farinosa f. sp. betae newly reported on Swiss chard in Korea. New Disease Reports (2009). 2009, Vol. 19, 40. LYSLE D. LEACH, 1931. Downy mildew of beet caused by Peronospora schachtii fuckel. Hilgardia, a journal of agricultural science, published by the California Agricultural Experiment Station. Vol. 6, No. 7. PEGG Ken, MANNERS Andrew, COATES Lindy, DUFF John, COOKE Tony, 2015. Downy Mildew, early management is critical. pest and disease fact sheets as part of NY11001 Plant health biosecurity, risk management and capacity building for the nursery industry in 2015. PHILIP DRAYCOTT, A. 2006. Sugar Beet. s.l. : Blackwell Publishing Ltd, 2006. SBN-10: 1-4051-1911-X - SBN-13: 978-1-4051-1911-5. PLANTWISE. sugarbeet downy mildew (Peronospora farinosa f.sp. betae). Plantwise Knowledge Bank. [En ligne] [Citation : 09 10 2014.]. RUSSELL, G.E. 1966. THE EFFECT OF INFECTION WITH PERONOSPORA FARINOSA ON THE SUSCEPTIBILITY OF SUGAR BEET TO ERYSIPHE BETAE. Plant Pathology. Plant Pathology, 1966, Vol. 15: 97–100, doi: 10.1111/j.1365-3059.1966.tb00323.x. THINES Marco, CHOI Young-Joon, 2015. Evolution, Diversity, and Taxonomy of the Peronosporaceae, with Focus on the Genus Peronospora. Phytopathology, volume 106, Issue 1. January 2016, Pages 4-100. |
Agrément conseil de l’ITB à l’utilisation des produits phytosanitaires n° 7500002.
Assurance RC n° 05421646Y/1025.
Le portail EcophytoPIC recense les techniques alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Organisme agréé Crédit d'impôt Recherche
L'Institut Technique de la Betterave est
membre du réseau Acta
Institut Technique Agricole Qualifié
par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation